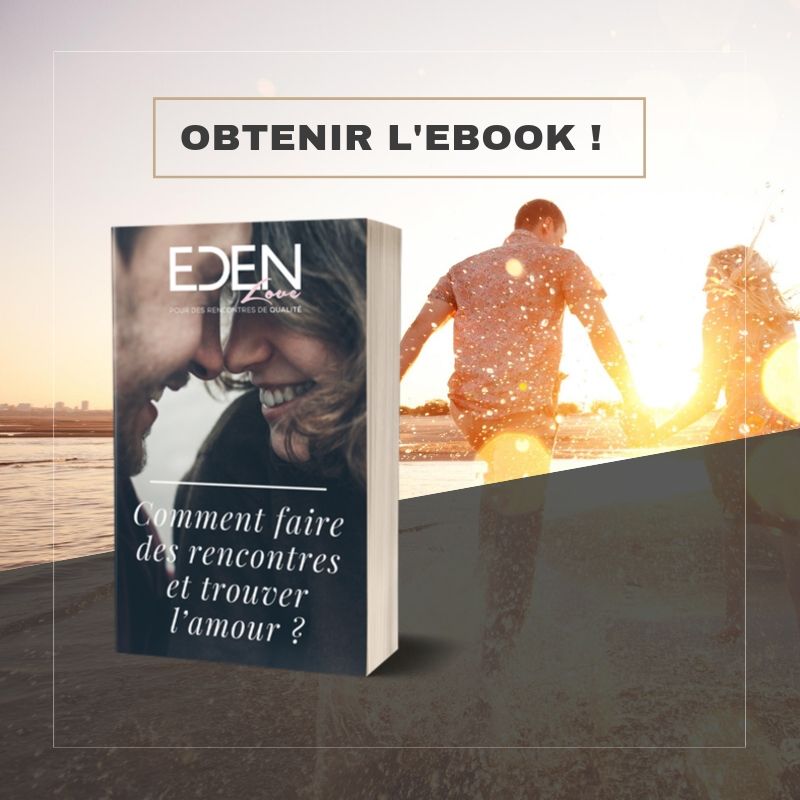En 2020, les notions de consentement sexuel et de non-consentement sont plus que d’actualité. Les faits divers qui évoquent ces termes sont nombreux, et il est parfois difficile de s’y retrouver. Nous faisons le point sur tout ce qui touche le consentement sexuel et le non-consentement, de près ou de loin.
C’est quoi le consentement sexuel ?
Le consentement sexuel est un terme utilisé pour désigner l’accord mutuel que les personnes se donnent avant qu’une activité sexuelle ait lieu entre elles. En somme, exprimer son consentement revient à donner oralement son accord pour un acte sexuel partagé avec une autre personne. Pour être valable, le consentement doit être clair, libre et éclairé. Céder, ce n’est pas consentir. Une personne qui ne dit rien ou qui garde le silence n’est pas considérée comme une personne consentante.
Le consentement, une notion à comprendre
Il est important de vérifier que son partenaire est consentant avant de débuter une activité sexuelle. Pour cela, il faut lui poser la question directement. De plus, il faut aussi renouveler son consentement avant d’entreprendre une autre activité sexuelle. On peut dire oui à certains gestes et dire non à d’autres ! Ainsi, on peut donc consentir à un baiser, mais refuser les caresses ou la relation sexuelle. Enfin, on peut aussi arrêter une activité sexuelle à tout moment. Dès lors que l’un des partenaires exprime son refus par des gestes ou des paroles, il faut cesser l’activité sexuelle.
 Être capable de donner son consentement
Être capable de donner son consentement
Chaque personne doit être capable de donner son consentement pour que l’on puisse considérer celui-ci comme valide. À ce titre, la loi prévoit des situations où on ne peut pas établir la validité du consentement. C’est le cas lorsqu’une personne est inconsciente ou endormie, par exemple. Idem pour les personnes alcoolisées ou droguées au point d’être inconscientes, en coma éthylique ou en état de « black-out ».
Enfin, la loi considère que les enfants de moins de douze ans ne peuvent pas donner un consentement valide. Quant aux adolescents, ils peuvent consentir aux actes sexuels sous certaines conditions : âge, âge du partenaire, etc.
La définition du non-consentement
Si l’on tient compte de la définition du « consentement sexuel », on peut tirer une définition du non-consentement. Ce terme désigne le désaccord d’une personne face à un acte sexuel. Il n’y a pas besoin de résister physiquement pour montrer que l’on n’est pas d’accord. Un « non » suffit. De la même façon, céder à l’acte (ne rien dire et se taire) désigne aussi une forme de non-consentement.
Dès lors que le consentement n’est pas clair, il n’est pas valide. On parle de non-consentement. Cela concerne alors les personnes de moins de douze ans, les personnes intoxiquées à l’alcool ou à la drogue, les personnes qui ont exprimé leur refus ou celles qui n’ont pas exprimé leur consentement.
Qu’est-ce que la présomption de non-consentement des mineurs ?
La notion de présomption de non-consentement des mineurs concerne les mineurs et permet de les préserver des actes sexuels non consentis. Ainsi que des actes de violence sexuelle.
Lutter contre les violences sexuelles
Grâce à cette mesure, une présomption de non-consentement s’applique à tous les mineurs de moins de quinze ans. En dessous de cet âge, les relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de quinze ans sont considérées comme un viol.
À ce titre, la loi considère les mineurs comme des personnes fragiles et non consentantes. En effet, comme le précise la définition du consentement sexuel, il faut être éclairé et être en capacité de donner son accord. La création de ce seuil (quinze ans) a fait l’objet d’un débat au gouvernement. La présomption de non-consentement des mineurs permet de tenir les adultes responsables. Mais aussi d’éviter qu’ils ne fassent croire à l’enfant qu’il est consentant. Aux yeux de la loi, c’est à l’adulte de refuser l’acte avec une personne âgée de moins de quinze ans. De la même manière, un acte non consenti entre deux adultes est aussi une violence sexuelle.
Pourquoi le consentement est-il important ?
Le consentement est important pour fixer un cadre légal solide et protéger les victimes de viol, d’abus ou d’agressions sexuels. Le consentement, c’est bien plus que dire « oui ». C’est donner son accord et éviter tout problème.
Sans consentement, on considère les activités sexuelles comme des instances de violence sexuelle. Et celle-ci comprend les cas de harcèlement sexuel, ainsi que les cas d’agression sexuelle. Le premier désigne les comportements physiques ou verbaux de nature sexuel et non désiré. L’agression sexuelle désigne les actes sexuels non désirés par une personne sur une autre. Cela comprend donc les caresses, les baisers, le sexe oral ainsi que les rapports avec pénétration.
Comment reconnaître les violences sexuelles ?
La loi reconnaît la violence sexuelle lorsqu’on n’obtient pas le consentement de l’autre, ou que l’on ne donne pas son consentement. Toutes les situations qui entrent dans le cadre du non-consentement peuvent faire l’objet de poursuites judiciaires. Ainsi, donner son consentement permet d’exprimer sa volonté de s’adonner à une pratique sexuelle. Mais aussi de protéger son partenaire par la suite. À l’inverse, demander le consentement de son ou de sa partenaire permet de s’assurer qu’il ou elle est réellement d’accord de pratiquer l’acte en question. Et donc, d’éviter toute poursuite judiciaire.
Mais il faut aussi tenir compte de l’impact psychologique qu’une violence sexuelle peut avoir sur quelqu’un. On ne veut en aucun cas en être victime ou l’infliger à l’autre. D’où l’importance d’obtenir ou de donner son consentement sexuel avant tout acte considéré par la loi.


 Être capable de donner son consentement
Être capable de donner son consentement